|
Les
vagues
Leur formation.
Une vague est une onde mécanique qui
se propage à la surface de contact entre deux fluides, en
l'occurrence l'eau et l'air. Comme toute onde digne de ce nom, elle est
caractérisée par une longueur d'onde, une
amplitude, une période et une
célérité.
Plus la longueur d'onde d'une vague est importante, plus sa vitesse ou
célérité est grande. Gibus de
Soultrait dans son livre 'L'homme et la vague' nous donne un exemple
très caractéristique. " La vitesse d'un tsumani,
vague de raz de marée
générée par un tremblement de terre
sous marin, peut avec une longueur d'onde de 240 km, atteindre 725
km/h, en filant inaperçue sous un bateau en mer ".
La
célérité de la vague croît
avec son amplitude. Cependant, lorsque la vague atteint le rivage, son
amplitude varie en fonction du relief sous marin et de la configuration
du rivage.
La naissance des vagues.
Beaucoup de personnes pensent que les
marées sont à l'origine de la formation des
vagues. Les marées sont dues à l'attraction des
astres et sont d'amplitude plus ou moins forte selon l'alignement du
soleil et de la lune à l'axe de la terre. Mais d'aucune
façon les marées ne crées les vagues,
même si, localement, elles peuvent influer sur leur
déferlement.
La principale cause de la formation des vagues est le vent. Celui-ci
est créé en se déplaçant
d'un anticyclone (zone de haute pression) vers une
dépression. Ainsi, à la surface de l'eau, le vent
s'écoule de façon turbulente et provoque
l'apparition d'ondulations plus ou moins marquées en
fonction de sa force. En effet, même à une
échelle locale, le champ des pressions n'est pas uniforme et
entraîne donc cette turbulence.
La grosseur des vagues va donc dépendre de la force du vent,
mais également de sa durée et de
l'étendue, appelée le FETCH , sur laquelle il
souffle; en bref de l'énergie que le vent cède au
milieu marin.
A titre d'exemple, un vent de 40 km/h soufflant sur 200 km durant 15
heures engendre des creux de 2,5 mètres...et de 11
à 14
mètres s'il se met, pendant la même
période,
à souffler à 100 km/h sur un fetch de 400 km.
Malheureusement, la formation puis la croissance de l'agitation sous
l'effet du vent sont des processus encore mal connus.
D'amplitude, de longueur d'onde, et de
célérité différentes, les
vagues, formées au sein d'une dépression
météorologique, rayonnent alors plus ou moins
nettement à partir d'une "zone centrale" ou encore
appelée "zone de génération".
Cependant, seules les vagues ayant une vitesse inférieure ou
proche du vent peuvent être entretenues et voyageront
à travers l'océan. Les autres
déferleront et formeront ce que l'on appelle dans le langage
océanographique "les moutons", c'est à dire les
mousses du large.
En résumé, les dépressions et donc les
tempêtes au large sont à l'origine des
ondes qui plissent la surface de l'océan, s'ordonnant alors
en ondes successives, dites "trains de houle'".
Le
voyage des vagues.
A grande
distance, les
vagues se propagent dans des étendues marines où
le vent
n'a pas de rapport avec celui qui régnait dans la zone de
génération. Les lames sont alors
constituées
d'ondulations relativement régulières en
direction, comme
en période, avec de longues crêtes, que l'on
appelle la
houle .
Le mouvement de la houle résulte du transfert permanent de
l'énergie liée à la pesanteur, et
à la
cinétique du mouvement elliptique des particules d'eau.
Celles-ci tournent sur elles même à la verticale,
la
pesanteur faisant passer l'onde d'une colonne d'eau à
l'autre.
En effet, les particules d'eau ne se déplacent pas. Pour
mieux
comprendre, prenons l'exemple d'un bouchon sur l'eau; La houle le
ballote mais ne le déplace pas.
L'action de la gravité va également quelque peu
favoriser
l'étalement de la houle et du coup augmenter sa longueur
d'onde,
élément déterminant de sa vitesse.
Ainsi donc la houle est comparable à un mouvement pur dont
la
théorie indique que si rien ne l'altère, il est
infini et
surtout ne perd rien de son énergie de départ.
Par
exemple si rien ne venait la perturber, une vague en mer de 10
mètres mettrait 3 ans pour descendre à 4
mètres
(puisqu'il y aurait tout de même une perte
d'énergie par
frottements entre les particules d'eau).
Leur
arrivée sur nos cotes.
Forte de son long voyage à travers l'océan, la
houle est
prête à déferler sur notre rivage et
à faire
le bonheur de tous les adeptes des sports de glisse.
Une vague déferle lorsque sa courbure devient
très
accentuée, mathématiquement lorsque l'amplitude
crête à creux dépasse 14 % de la
longueur d'onde.
Cette situation peut arriver en mer ; C'est le cas des
déferlantes rencontrées au large. Mais quelle est
la
cause du déferlement des vagues sur nos côtes ?
Lorsque la profondeur diminue à l'approche de la
côte, les
éléments de la houle varie et le profil de la
houle se
modifie.
Quand la profondeur de la mer devient inférieur à
la
moitié de la longueur d'onde, le fond a pour effet de
ralentir
la houle à son voisinage par frottement des particules
d'eau.
L'amplitude du mouvement augmente alors en même temps que la
hauteur de crête, jusqu'à atteindre une courbure
limite et
provoquer un basculement de l'eau vers l'avant : C'est le
déferlement
La puissance du déferlement et la projection de la
crête
prennent des proportions d'autant plus impressionnantes que la houle
est plus haute et la pente du plateau continental plus abrupte.
A partir de là, on comprend la différence de
puissance
entre une vague déferlant sur l'île d'Hawaii,
où
les fonds marins plongent abrupts à quelques centaines de
mètres du rivage et, par exemple, une vague atteignant notre
côte Bretonne devant laquelle le plateau continental
s'étend en pente douce sur plusieurs dizaines de
kilomètres.
En effet, au moment où la vague de grande longueur d'onde,
allant donc très vite, frappe la côte nord
d'Hawaii, la
puissance de la vague est quasiment la même qu'en plein
océan.
Inversement, freinée par un fond remontant doucement, une
vague
de longueur d'onde identique sera considérablement moins
forte
en déferlant sur le rivage des plages Bretonnes.
Ces mêmes raisons expliquent la puissance des vagues en
Aquitaine, le golfe de Gascogne plongeant très profondement
au
raz des côtes, notamment au niveau de la fosse de Capbreton.
Nous avons pu noter durant cette étude que les eaux de mer
étaient déplacées par un certain
nombre de forces
naturelles : les ondes de tempête et de marée, les
ondes
sismiques, et bien sur l'action du vent.
De plus nous avons pu montrer que la morphologie de la vague changer en
fonction du lieu géographique où nous nous
situons. En
effet, la morphologie de la vague dépend du relief
sous-marin et
de la configuration du rivage. Les marées et les vagues
constituent des sources potentielles d'énergie et peuvent
donc
être bénéfiques. On sait qu'une houle,
même
modérée, peut fournir 40 kW par mètre
de
côte.
Cependant les scientifiques manquent de données
quantitatives
sur les caractéristiques des vagues en mer, car celles-ci ne
sont observées et enregistrées
systématiquement au
large qu'en fort peu de points. Même si à bord des
navires
océanographiques stationnaires et sur les plates-formes off
shore , les données climatologiques des vagues sont
relevées régulièrement.
|
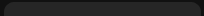 |
|
Les petits plus sympas!

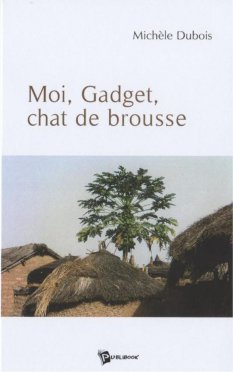
L'histoire
de deux chats et de leurs
aventures en Afrique... Un roman frais, où la
tendresse se lie à la
réflexion.


Un
site qui explique comment arrondir vos fins de mois trés
facilement avec votre ordinateur!

|
|
 |
|



